
Netanyahu boycotte la cérémonie en hommage a Yitzhak Rabin
Trente ans après l’assassinat de Yitzhak Rabin, la mémoire du Premier ministre tombé en 1995 reste un miroir impitoyable des divisions israéliennes. Cette année, l’onde de choc a pris une forme inédite : Benyamin Netanyahou a décidé de ne pas se rendre à la cérémonie d’État au mont Herzl, pourtant organisée par son propre cabinet. Le président de la Knesset, Amir Ohana, a lui aussi choisi de ne pas participer, laissant son vice-président représenter l’institution. À l’inverse, le président Isaac Herzog et le président de la Cour suprême, Yitzhak Amit, ont confirmé leur présence — signe qu’au sommet de l’État, l’exigence de continuité institutionnelle l’emporte encore sur le tumulte politique.
Ce geste de boycott, rare à ce niveau de la hiérarchie, intervient alors que la commémoration connaît un retour de forte mobilisation civile. À Tel-Aviv, la grande veillée en hommage à Rabin refait surface après plusieurs années de pause dues aux travaux et aux contraintes de guerre : une marche est prévue en amont depuis la centrale électrique de Reading jusqu’au site du rassemblement, près de l’esplanade du mémorial sur Ibn Gvirol. Les autorités municipales et la police ont bouclé un large périmètre, avec des fermetures d’axes entre 17h30 et 23h00 — contraste saisissant entre la solennité du cimetière national et l’énergie de la place publique où l’on se rassemble pour écouter, débattre, parfois contester.
Depuis trois décennies, chaque 12 Heshvan recompose la même question : que commémore-t-on exactement ? Le chef d’état-major devenu homme d’État ? Le signataire des accords d’Oslo ? La victime d’un meurtre politique qui a révélé la part sombre de la polarisation ? Dans l’Israël de 2025, la réponse n’est pas univoque. Un sondage publié à la veille de l’anniversaire montre que 51 % des Israéliens jugent l’héritage de Rabin positif, 28 % négatif, et près d’un quart restent indécis. Plus parlant encore, un tiers des répondants estime que le pays se porterait mieux si Rabin avait vécu, quand 22 % pensent l’inverse — façon implicite de dire que l’assassinat a, pour beaucoup, nui au destin national, tandis qu’une minorité considère que l’histoire a suivi une trajectoire préférable.
La même enquête traduit une inquiétude sourde : à l’approche de ce trentième anniversaire, environ deux tiers des personnes interrogées disent craindre la possibilité d’un nouvel assassinat politique. Cette donnée ne relève pas du réflexe commémoratif ; elle reflète le climat d’une société qui, depuis le 7 octobre et la guerre, navigue entre résilience et crispation. Les dirigeants institutionnels — président, magistrats, hauts responsables — tentent d’inscrire la journée dans un registre de cohésion : silence, dépôt de gerbes, prières, protocole. Mais l’absence du Premier ministre et du président de la Knesset à la cérémonie officielle envoie un signal inverse, perçu par beaucoup comme l’abandon d’un rituel que l’on croyait, justement, au-dessus de la mêlée.
À Tel-Aviv, la scène civile raconte autre chose. L’hommage populaire — discours, lecture du « Shir LaShalom », minute de silence à l’heure exacte des tirs — revendique une mémoire ouverte, parfois militante, presque toujours pluraliste. C’est la force de cette commémoration : elle rappelle qu’en Israël, la rue peut être un forum civique, non un tribunal. Elle rappelle aussi que la mémoire de Rabin est inséparable d’une idée d’Israël : un État fort, capable de se défendre, mais suffisamment sûr de lui pour se confronter, sans haine, à ses désaccords internes.
Honorer Rabin, c’est d’abord réaffirmer un principe simple : la souveraineté d’Israël se protège par la force de Tsahal, mais elle se perpétue par l’État de droit, l’unité nationale et le refus absolu de la violence politique. Dans une période de menaces extérieures et d’épreuves, la meilleure réponse pro-Israël consiste à maintenir les institutions au premier plan, à respecter les cérémonies d’État qui rassemblent, et à débattre fermement — mais loyalement — de l’orientation stratégique du pays. C’est ainsi qu’Israël demeure ce qu’il doit être : une démocratie sûre d’elle, décidée à se défendre et à se projeter vers l’avenir.
Jforum.fr
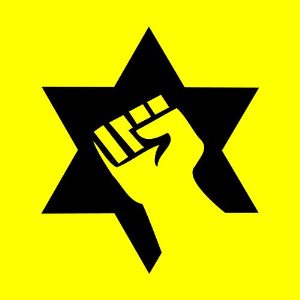
30 ans il est venu le temps de libérer Ygal AMIR