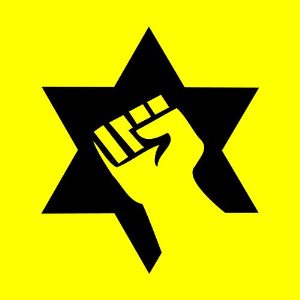DEPORTATION :Quand Marine Tondelier navigue entre vulgarité et haine .
Israël organise la « déportation » des membres de la flottille de Gaza, soutient Marine Tondelier
En qualifiant de « déportation » l’expulsion d’une élue depuis Israël, Marine Tondelier efface la distinction fondamentale entre vocabulaire administratif et mémoire de la Shoah : un raccourci lexical qui n’est jamais sans conséquence dans le débat public.
Lors de l’émission Bonjour !, sur TF1, le 10 octobre 2025, Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, a été interrogée au sujet de Mélissa Camara, eurodéputée arrêtée par Israël après l’interception d’un navire humanitaire en direction de Gaza. Elle a expliqué avoir multiplié les démarches auprès des autorités françaises, exprimé une inquiétude profonde et rapporté que plusieurs parlementaires étaient revenus en France après avoir signé, sous contrainte, un document imposé par Israël – ce qu’elle conteste. Elle a insisté sur le sort particulièrement préoccupant de Mélissa Camara, dont elle affirme qu’elle est incarcérée et « déportée » sous 72 heures, choisissant explicitement ce terme en le présentant comme relevant d’un cadre juridique officiel employé par les autorités israéliennes.
Le journaliste Bruce Toussaint l’a alors interrompue en soulignant avec gravité l’inadéquation et la charge historique du terme : « La déportation, Madame Tondelier ? La déportation ? » Malgré cette interpellation, Marine Tondelier a maintenu son choix lexical, arguant qu’il s’agissait d’une mesure juridique – « C’est le terme qui est dans les papiers israéliens » – défendue par des juristes au téléphone, tout en affichant une certaine crispation. Ce dialogue tendu a laissé le plateau dans une atmosphère marquée par la gêne, notamment avec le silence et le regard baissé d’Adrien Gindre.
Un choix qui dépasse la simple maladresse
À première vue, rien ne permet de dire que Marine Tondelier ait eu l’intention délibérée de nuire à la mémoire des victimes de la Shoah, sa défense reposant sur une prétendue conformité lexicale juridique. Cependant, insister sur ce terme, en dépit de son poids considérable en français et des alertes du journaliste, dépasse la simple maladresse. Il faut bien saisir que, en anglais, le mot « deportation » désigne essentiellement une expulsion administrative d’un étranger ou résident hors du territoire conforme aux droits de l’immigration ; en revanche, en français, « déportation » est imprégné du souvenir atroce des déportations nazies, notamment des juifs et résistants vers les camps de concentration, un terme chargé d’une douleur historique.
Dans cette optique, il est nécessaire, pour appréhender pleinement la portée de ce mot, que Marine Tondelier s’immerge dans le Mémorial de la déportation des juifs de France de Serge Klarsfeld. Cet ouvrage, fruit d’un travail patient et rigoureux entamé en 1975 et poursuivi sur plusieurs décennies, recense avec une précision remarquable les 76 000 juifs déportés de France entre 1942 et 1944, dont plus de 11 000 enfants. Il retrace, pour chaque convoi, les identités, les âges, les lieux d’arrestation et le parcours jusqu’aux camps d’extermination, mettant en lumière l’ampleur humaine et historique de cette tragédie collective.
Stratégie militante
Car, cette mémoire, préservée avec minutie dans ce Mémorial, impose un devoir de rigueur dans l’usage du vocabulaire, d’autant plus lorsqu’il s’agit de termes marqués par la souffrance et la barbarie. Employer à tort « déportation » dans un contexte administratif contemporain revient à diluer ce patrimoine de mémoire collective, à banaliser la douleur des victimes et à fragiliser le langage politique, qui doit, plus que jamais, incarner exemplarité et responsabilité.
Certes, en choisissant de porter cette controverse sur des mots chargés, Marine Tondelier engage une stratégie militante claire : elle veut maximiser son impact, polariser le débat et mobiliser un public sensible à l’émotion. Pourtant, franchir cette ligne rouge risque de provoquer rejet et incompréhension, de réaliser une fracture mémorielle qui mine la cohésion nationale et affaiblit la force du message politique.
Il appartient aux responsables politiques de mesurer la portée de leurs paroles, car derrière chaque mot se trouve un héritage historique et moral. L’usage des termes les plus lourds d’histoire n’appartient pas à la simple rhétorique : il engage un devoir d’exemplarité, dont dépend la préservation non seulement de notre mémoire commune mais aussi de la qualité et de la dignité du débat démocratique.
SOURCE LE POINT
happywheels