
Ce que cache la « nouvelle France » de Jean-Luc Mélenchon
Le leader Insoumis entend fédérer les « racisés », les femmes et les villes. Un amalgame dangereux qui n’a pas pour moteur l’égalité, mais l’esprit de revanche.
Par Saïd Mahrane
Il faut avoir conscience de la portée du « décret ». Jean-Luc Mélenchon répète à l’envi qu’il appartient désormais – lui et d’autres – à la « nouvelle France ». De quoi est-il question ? À quoi fait-il allusion ? Il ne parle pas ici d’une nouvelle République ou même d’un nouveau régime, mais de la fin de la France originelle et de sa renaissance sous d’autres traits.
À dessein, le leader des Insoumis confond la société, soit la structure de la vie collective – d’abord façonnée par le marché et la consommation, qu’il abhorre –, et la France, en tant qu’identité collective. Pour lui, cette France historique et symbolique doit être abandonnée au profit d’une addition d’identités narratives, celles d’individus revendiquant des droits et de minorités réellement ou non stigmatisées. « Écoute aujourd’hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le Chant du Malheur », déclarait André Malraux lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, inscrivant cette jeunesse dans une continuité historique.
Par électoralisme, Mélenchon, lui, acte une révolution démographique et l’avènement d’un peuple nouveau. En bon trotskiste, il s’emploie, par des mots et des concepts, à donner forme et, surtout, une conscience politique à cet agrégat de communautés. Le but : faire une nation, au sens de l’unité, avec les sentiments mobilisateurs que cela induit. Il proclame le début d’une ère nouvelle, l’« ère du peuple », faisant fi du passé, tel Saint-Just devant la Convention en 1794 : « Le monde est vide depuis les Romains […] Le bonheur est une idée neuve. » La « nouvelle France » est constituée, selon son inventaire, de « la population des villes, des femmes et des racisés ». Ceux qui ne correspondent pas à cet ordre catégoriel seront-ils priés de renoncer à toute destinée commune ? Par un biais qu’il veut positif, donc acceptable par les gardiens de la morale publique (médias, intellectuels, associations…), Mélenchon s’inspire en réalité de procédés des plus douteux.
Fascisme ?
Choisir un idéal populaire selon des critères ethniques (racisés), de genre (les femmes) et géographiques (les villes) n’est rien d’autre qu’une discrimination que tolèrent ceux qui voient dans ce tri la réparation attendue d’injustices faites à ces catégories. « Mélenchon n’est plus de la gauche universaliste, mais du fascisme de gauche », estime Pascal Bruckner. « Le fascisme est une forme moderne de sacralisation de la politique, qui prétend transformer les masses en une communauté homogène, en exaltant la nation, le chef et l’État », selon la définition de l’historien italien, spécialiste du fascisme, Emilio Gentile. Mélenchon fait l’éloge d’une nation créolisée, dont – il va de soi – il sera le chef, tandis que l’État sera au service de cette transition.
À l’instar d’autres avant lui, le leader Insoumis considère la France comme un organisme vivant, qui rajeunit, vieillit, meurt, ressuscite ou se régénère. Joseph Staline parlait de l’avènement d’un « peuple soviétique ».« Notre but est de renverser les forces de l’impérialisme et du féodalisme, et de construire une société nouvelle, où le peuple nouveau sera maître de son destin », écrivait Mao dans La Démocratie nouvelle. Nasser, en Égypte, après la période décoloniale, évoquait « la naissance des peuples libérés ».
Comme Renaud Camus
Quant à Philippe Pétain, en 1941, il publia La France nouvelle, un court livre détaillant la forme institutionnelle qui convient le mieux à un pays occupé… Sans le dire ainsi, Mélenchon fait le constat de la fin du peuple ethnos, celui qui, jusqu’au XIXe siècle et les premiers phénomènes migratoires intra-européens, était relativement homogène – en dépit des disparités régionales. Renaud Camus avec son concept de « grand remplacement » ne dit pas autre chose – mais lui incarne la forme négative du « constat », celui de la déploration et de la xénophobie.
Bien qu’il s’en défende, Mélenchon a un projet qui vise à la désunion historique et au détachement des appartenances républicaines anciennes. Alors même qu’il existe parallèlement au sein du peuple hors métropoles une volonté de retrouver l’esprit des communautés de proximité (famille, voisinage, association, club de sport…), il entend invisibiliser ces habitants des campagnes et les Français de vieille souche.
Puissance des affects
La régénération de la France se produit, selon lui, exclusivement dans ces milieux urbains, où cohabitent la jeunesse immigrée, les militants féministes, LGBT et une bourgeoisie à la fois solidaire et en surplomb (donc séparée). Connaissant mieux que personne la puissance des affects en politique, Mélenchon et ses amis jouent avec un sentiment dangereux : celui de la revanche. Si une certaine droite joue de la peur, cette gauche, elle, nourrit l’esprit de revanche à l’endroit de l’ancien colonisateur, de l’homme blanc masculiniste, de l’État républicain, de ses services d’ordre…
Métissage, déracinement, autodéfinition, rupture historique… Mélenchon associe ce processus au mythe du progrès, fort mobilisateur à gauche. À défaut d’une égalité citoyenne réelle et d’un progrès social pour tous, par-delà les caractéristiques ethniques et géographiques, Mélenchon – amateur de mytho-politique – répond par une mythologie nouvelle.
« La créolisation est un fait »
« Ordem e Progresso », a inscrit le Brésil – cette nation mestiçagem (« métissée ») – sur son drapeau, empruntant cette devise à Auguste Comte, à l’origine du positivisme, philosophie qui prône une réflexion basée sur les faits et non sur la spéculation et les concepts. C’est donc ainsi qu’il faut entendre cette phrase de Mélenchon, récemment prononcée : « La créolisation est un fait, pas un projet politique. »

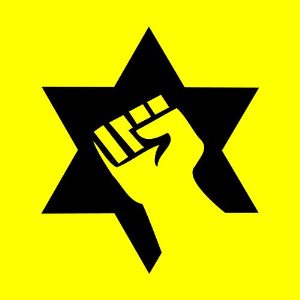
Et c’est pour ça que gabriel attal a appelé à se désister et à voter aux deuxième tour des dernières législatives ? Dire que micron reprend mot pour mot ad nauseam les éléments de langage antisémite et antisioniste de doriochon. A vomir
Qu’il se souvienne comment a fini ROBESPIERRE .
Une anecdote ;
Quand Nasser a pris le pouvoir en 1953 , il a reçu les frères musulmans.
Il leur a demandé s’ils avaient une requête à lui solliciter.
Leur représentant a répondu qu’il souhaitait qu’il exige que toutes les femmes portent le voile .
Nasser : » vous avez une fille qui est inscrite à la faculté de médecine et elle ne porte pas le voile….
Vous , vous n’arrivez pas à faire porter le voile à une seule fille ….comment pourrai je le faire porter à 10 millions de femmes » en se tordant de rire sous les applaudissements du public .
A voir à tout prix ….tant qu’elle est en circulation….si LDJ l’autorise .
https://youtu.be/aZ5soELzEP4?si=aS1Dpp8NLYFSR6tZ
Blast est un média indépendant français fondé en 2021 par le journaliste Denis Robert. Il combine une plateforme d’information généraliste et une web TV, diffusant des enquêtes, éditoriaux, chroniques et reportages. La ligne éditoriale est ancrée à gauche.
En juin 2024, Blast comme 90 médias français appelle à faire « front commun » contre l’extrême droite, qui selon eux menace la liberté de la presse en France et à soutenir la coalition de gauche du Nouveau Front populaire dans le cadre des élections législatives anticipées
Merci d’abord de l’avoir passé et pour ces précisions.
J’ignorai ce media bien sûr.
En tout cas je trouve ce Monsieur très courageux, je partage tout ce qu’il dit .
Encore merci .
Moi j’ai retenu qu’il ne votait pas MELANCHON, ça m’a suffit .
Maintenant je sais et encore merci .
Aujourd’hui avec les réseaux sociaux tout peut basculer très vite.
On parle de plus en plus de généraux qui refusent d’envoyer leurs soldats en UKRAINE .
L’étau se resserre sur les MACRON.
Sans oublier l’échéance du 17 Septembre où une jeune américaine les attend de pied ferme pour un procès où les MACRON en déposant plainte contre elle sont tombés dans un piège où ils auront du mal à se relever .
En plus mal conseillés par des hommes avides de millions de dollars ….. là on est en Amérique avec des lois differences ….
« différentes ».
Scusi
Leur chance unique est que le procès aurait lieu dans le DELAWARE….. État démocrate.
Loin d’être suffisant car tout le monde aux EU et dans le monde se demandent ce qu’un Président vient faire dans cette galère .