
Les Mamdani, père, mère juive, femme, tous antisémites
Un père intellectuel persécuté et une mère cinéaste divorcée juive : voici la famille Mamdani
Le nouveau maire de New York, Zoharan Mamedani, a fait sensation avec ses positions progressistes et anti-israéliennes. Mais lorsqu’on s’intéresse à son entourage, on constate que les chiens ne font pas des chats : sa mère, la réalisatrice Mira Nair, a été invitée au Festival du film de Haïfa et a déclaré qu’elle viendrait « quand l’occupation sera terminée ». Son père, l’universitaire Mahmoud Mamedani, a été expulsé deux fois d’Ouganda et a lutté pour les droits des minorités, et son épouse, l’artiste Rama Dewaji, peint des tableaux à message pro-palestinien en tant que première dame de la ville.
Pendant la majeure partie de sa jeunesse, Zohran Mamdani était connu du public comme « le fils de… », l’enfant prodige de ses parents, figures emblématiques du cinéma et du monde universitaire : la réalisatrice indienne novatrice Mira Nair et l’éminent anthropologue Mahmoud Mamdani, professeur à l’université Columbia. Mais aujourd’hui, à seulement 34 ans, le jeune Zohran fait la une des journaux en tant qu’homme politique aux États-Unis et dans le monde entier, notamment en Israël, où l’idéologie qu’il défend suscite la crainte.
En tant que personnalité publique, Mamdani Jr. attire beaucoup l’attention, et suscite aussi la controverse, notamment en raison de ce qu’il représente en tant que nouveau maire de New York, le premier à se déclarer musulman chiite. De prime abord, cela semble contradictoire avec ses positions socialistes et progressistes qui ont rallié les masses, y compris les membres de la communauté LGBT qu’il a promis de soutenir. Mais lorsqu’on considère son milieu d’origine, au sein d’une famille imprégnée de pensée libérale, d’une vision du monde pluraliste et de création artistique, on comprend mieux comment les contradictions de sa personnalité s’équilibrent.
L’une des principales raisons de la réticence de ses adversaires envers Zoharan tient au fait que sa biographie, son image et sa personnalité ne correspondent pas aux stéréotypes habituels de la pensée conservatrice, et certainement pas à la pensée raciste. Le nouveau maire de New York n’est devenu citoyen américain qu’en 2018, vingt ans après l’immigration de sa famille aux États-Unis depuis son Ouganda natal. Son parcours l’a mené, à l’âge de sept ans, de ce pays africain sous-développé à l’Amérique du Nord, terre de possibilités infinies. Pourtant, les racines de ses parents se trouvent en Inde, où ils sont tous deux nés. Sa mère, Mira, est issue d’une famille hindoue de l’État d’Odisha et a immigré aux États-Unis très jeune, tandis que son père, Mahmud, est né à Mumbai de parents musulmans chiites issus de la communauté indienne d’Afrique (fondée sous l’égide du colonialisme britannique). Après un retour à Dar es Salaam, en Tanzanie, la famille Mamdani s’est installée à Kampala, en Ouganda, ville natale de Mahmud et où Zoharan est né des décennies plus tard.
L’universitaire qui a été persécuté, expulsé et est revenu.
L’arbre généalogique étendu de la famille Mamdani, enraciné dans de nombreux endroits du globe, a sans aucun doute influencé la vision du monde de l’homme politique Zohran et son ouverture aux immigrants, aux étrangers et aux personnes issues de différentes communautés aux identités diverses, parfois conflictuelles. Mais au-delà de l’influence géographique sur sa biographie, ce sont précisément les aspirations spirituelles de ses parents qui l’ont marqué, comme en témoignent la filmographie de sa mère Mira et la bibliographie de son père Mahmoud. Bien qu’il ait choisi l’activisme politique comme moyen de mettre en œuvre son idéologie, celle-ci a été façonnée par les idées que lui ont transmises ses parents, exprimées dans les livres et au cinéma.
Mahmoud Mamdani, 79 ans, est conférencier, penseur et commentateur politique chevronné. Il enseigne actuellement à la prestigieuse université Columbia de New York (devenue tristement célèbre depuis les manifestations étudiantes du 7 octobre). Avant de s’installer aux États-Unis, il a connu une vie mouvementée et riche en expériences, marquée par la persécution, la discrimination et la cruauté dans les pays du « Tiers Monde » de son enfance, dont il a pu s’échapper grâce à son éducation.
Né à Mumbai à la veille de la fin de la domination britannique en Inde, de parents indiens appartenant à la communauté musulmane gujarati, il a grandi dans les colonies britanniques d’Afrique. À l’âge de deux ans, ses parents sont retournés à Dar es Salaam (aujourd’hui capitale de la Tanzanie), leur ville natale, puis, quatre ans plus tard, ils se sont installés en Ouganda, à Kampala, sa capitale. Enfant, au sein d’une société locale divisée où la minorité indienne souffrait d’isolement et de discrimination, Mahmud a excellé en tant qu’élève dans un programme universitaire parrainé par les Américains, à la suite duquel il a remporté une bourse pour étudier aux États-Unis.
Mamdani Sr. fut admis à l’Université de Pittsburgh en 1963 et découvrit la montée des protestations publiques de l’époque, aujourd’hui connue sous le nom de Révolution américaine des droits civiques. Il se rendit en Alabama, épicentre de la lutte, où Martin Luther King avait osé s’opposer aux autorités locales et revendiquer l’égalité des droits pour les minorités. Captivé par cet esprit révolutionnaire, Mamdani se rendit en 1965 à Montgomery, dans le Sud, pour manifester dans le cadre du mouvement des droits civiques. Il se retrouva même en détention. Rétrospectivement, il raconta que lorsqu’il appela l’ambassadeur d’Ouganda aux États-Unis pour lui demander de l’aide, celui-ci lui demanda pourquoi il s’immisçait dans les affaires d’un pays étranger. Il répondit qu’il s’agissait d’un combat pour la liberté, une valeur universelle qui transcendait les luttes politiques locales et pour laquelle il fallait se battre. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait trouvé un fondement gothique à ses idées dans les enseignements de Karl Marx, qu’il adopta comme vision du monde. Ces fondements se retrouvent également dans le contexte idéologique du « socialiste » Zohran.
Dans l’esprit de l’internationalisme marxiste, qui reconnaît au sein de l’humanité une division fondamentale entre la minorité qui possède les ressources et le capital et la majorité qu’elle exploite, Mamdani décida de retourner en Ouganda après avoir obtenu une maîtrise en sciences politiques et relations internationales. Cependant, au lieu d’être accueilli comme un intellectuel qualifié capable de contribuer au développement de cette société arriérée, il fut expulsé en 1972, avec de nombreux membres de la minorité indienne du pays, sur ordre du dictateur Idi Amin, tristement célèbre en Israël pour son implication dans l’affaire des enlèvements d’Entebbe quatre ans plus tard. Malgré son expulsion et son statut de réfugié, il parvint à achever sa thèse de doctorat à la prestigieuse université Harvard et trouva un poste d’enseignant en Tanzanie, pays voisin de l’Ouganda, qu’il conserva. Il y retourna d’ailleurs après la chute d’Amin en 1979 et devint une figure universitaire de premier plan.
Bien que Mamdani ait été respecté au sein de la communauté universitaire internationale pendant des années comme anthropologue et penseur exceptionnel dans les domaines des sciences politiques et des relations internationales, il est resté fidèle à l’Ouganda, pays africain où il a grandi et dont il a été rejeté en raison de son appartenance à la minorité indienne. Il a même été contraint de le quitter une nouvelle fois en 1984 à l’initiative du gouvernement de Milton Obote, un autre dirigeant corrompu, qui lui a retiré sa citoyenneté suite à ses critiques de sa politique. Après deux ans d’exil en Tanzanie, il est retourné en Ouganda et y est resté jusqu’en 1993. Durant cette période, et dans un contexte de discrimination en tant qu’Indien en Ouganda, il a rencontré la réalisatrice Mira Nair, qui allait devenir sa femme. Leur premier rendez-vous a eu lieu à Nairobi, où la cinéaste indienne était venue des États-Unis pour effectuer des recherches en vue d’un scénario sur une héroïne indienne expulsée d’Ouganda enfant et assimilée aux États-Unis. Cette première rencontre a donné naissance à une histoire d’amour. Les deux se marièrent en 1991, et cette même année naquit leur fils, Zoharan, ainsi que le film « Mississippi Masala », créé par la jeune maman.
Le tour du monde avec Mira Nair
« Mississippi Masala », un mélodrame romantique un peu kitsch selon les critères actuels, avec un jeune Denzel Washington, reflète davantage la vie de Mahmud Mamdani que celle de son épouse, la réalisatrice, mais il est caractéristique de ses choix artistiques comme de sa vie personnelle. Nair, âgée de 68 ans, est née à Rourkela, dans l’État d’Odisha, au sein d’une famille hindoue d’origine punjabie. Contrairement à Mamdani, elle n’a pas connu l’occupation britannique ni les persécutions religieuses ou ethniques. Son parcours international a été guidé par sa grande ambition de jeune femme talentueuse ; à 19 ans, après avoir été admise à la prestigieuse université Harvard, elle quitte son pays natal pour étudier à l’étranger. C’est là qu’elle rencontre son futur partenaire artistique, le cinéaste indien Soni Trapurbala. Elle y fait également la connaissance du photographe Mitch Epstein, son professeur, qui deviendra son premier mari.
L’histoire d’amour de Nair avec cet Américain d’origine juive ne correspondait pas aux attentes conservatrices de sa famille indienne (ni aux préjugés de certains d’entre nous, qui voient dans chaque information susceptible d’associer Zohran Mamdani et sa famille à l’antisémitisme). Pourtant, comme on le verra plus tard dans les films de la réalisatrice, elle exprime sa vision humaniste qui place les individus et les liens intimes qu’ils partagent – amicaux ou amoureux – au-dessus des traditions religieuses et de l’héritage culturel dont ils sont issus.
À l’instar des personnages qu’elle incarnait à l’écran, elle aussi a lutté pour se libérer du carcan familial et de la société conservatrice dans laquelle elle avait grandi afin de partager une vie personnelle avec un homme qui n’était pas de sa famille. Leur relation amoureuse a débuté par une relation professeur-élève durant ses études, et en 1978, ils se sont rendus ensemble en Inde, où ils ont tourné le documentaire « Indian Cabaret ».
Epstein a admis dans des interviews que sa relation avec Nair avait rencontré de nombreux obstacles et objections liés à leurs différences ethniques et culturelles. Malgré cela, ils ont persévéré dans leur amour et se sont mariés en 1981. Ils ont partagé leur vie ensemble, tant à la maison que sur les plateaux de tournage, pendant huit ans, jusqu’à leur divorce en 1989. Durant cette période, Epstein a travaillé comme décorateur sur le film « Slam Bombay » (1988), qui a marqué un tournant dans la carrière cinématographique de Nair grâce à son regard provocateur sur les aspects les plus sombres de la vie urbaine en Inde, en totale contradiction avec les traditions.
Ironie du sort : Epstein a également coproduit « Mississippi Masala », film qui, comme mentionné précédemment, a réuni Nair et Mahmud Mamdani. On peut toutefois dire que l’intrigue mêle des éléments de la vie de ses deux partenaires. Tandis que l’héroïne Meena (interprétée par Sarita Choudhury) est la fille d’une famille indienne exilée d’Ouganda et qui a trouvé refuge dans l’État du Mississippi (à l’instar de son second mari), le personnage de Demetrius, l’Afro-Américain dont elle tombe amoureuse (Denzel Washington), fait écho à son premier mari, un Juif américain blanc, membre d’une minorité dont la relation personnelle abolit les barrières culturelles qui, au nom de la famille et de la tradition, étaient censées les séparer.
Malgré l’immense succès de « Slam Bombay » (récompensé par la Caméra d’Or à Cannes et valu à l’Inde une nomination aux Oscars du meilleur film étranger en 1989) et de « Mississippi Masala » (présenté aux festivals de Venise et de Sundance), qui l’ont consacrée comme une réalisatrice de premier plan sur la scène cinématographique internationale et ont révélé son talent pour mêler avec brio mélodrame romantique et critique sociale, Nadia Nair se consacra alors à sa famille. Elle s’installa à Kampala – une ville certes excentrée – pour rejoindre son mari Mamdani et élever leur jeune fils Zoharan. Plus tard, la famille déménagea au Cap, en Afrique du Sud, où Mamdani fut invité à enseigner. Malheureusement, l’épanouissement professionnel de Nair s’est enrayé, et les deux films qu’elle a réalisés pendant son exil volontaire d’Hollywood – le drame « The Perez Family » (1995), avec Marisa Tomei, Alfred Molina et Anjelica Huston dans les rôles des membres d’une famille cubaine en exil, et le drame érotique « Kama Sutra : A Love Story » (1996), qui était censé provoquer un autre remous du point de vue indien – n’ont pas rencontré le succès.
La vie dans un film
La renaissance de la carrière cinématographique de Nair, et dans une large mesure celle de son mari dans le milieu universitaire, a coïncidé avec son retour aux États-Unis en 1998 et son installation à New York, cette fois avec Zohran, alors âgé de sept ans. Tandis que Mahmud était invité à diriger le département d’études africaines de l’université Columbia, Nair commençait à travailler avec la scénariste Sabrina Dhawan sur « Monsoon Wedding », une comédie dramatique romantique relatant une cérémonie de mariage traditionnelle indienne qui dégénère. Le film, sorti en 2001, fut un succès commercial, rapportant 30 millions de dollars au box-office, après avoir valu à sa réalisatrice le Lion d’or à Venise (Nair était la première femme cinéaste à recevoir cette prestigieuse récompense).
Depuis « Monsoon Wedding », Nair s’est consacrée à des projets plus commerciaux, influencés par Hollywood et moins en phase avec ses racines ethniques et idéologiques. Elle a réalisé le téléfilm « Hysterical Blindness » (2002), avec Uma Thurman (qui a remporté la Palme d’Or pour sa performance), et en 2004, elle a adapté le roman « Vanity Fair » de William Makepeace Thackeray pour le cinéma, avec Reese Witherspoon dans le rôle principal. Warner Bros. Studios lui a proposé le rôle principal dans « Harry Potter et l’Ordre du Phénix » en 2005, mais elle a décliné l’offre, préférant renouer avec ses origines en adaptant le roman « The Good Name » de l’auteure indienne Jhumpa Lahiri. La rumeur court que c’est son fils qui l’aurait incitée à renoncer à cette production à gros budget pour se consacrer à un projet plus modeste. Peut-être s’agissait-il d’un acte de rébellion socialiste initial de la part de Zohran, alors âgé de seulement 14 ans, qui, grâce à une campagne réussie, a convaincu sa mère de refuser un revenu potentiel énorme et de remplir son cœur plutôt que son portefeuille.
Il ne fait aucun doute que, d’un point de vue capitaliste, il s’agit d’un échec retentissant, car Nair n’a pas réussi à obtenir de succès commercial depuis lors. Bien que son statut de cinéaste respectée soit resté intact auprès des critiques, le public n’a pas été convaincu. Le biopic « Amelia » (2009), consacré à l’aviatrice Amelia Earnhardt et avec Hilary Swank et Richard Gere, a été un flop, tout comme l’adaptation du thriller de Mohsin Hamid, « The Reluctant Fundamentalist » – avec Riz Ahmed, Liav Shriver, Kate Hudson et Kiefer Sutherland – qui a déçu après avoir fait l’ouverture de la Mostra de Venise en 2012. Une autre tentative pour percer en tant que réalisatrice commerciale a été entreprise sous l’égide des studios Disney, qui lui ont naturellement confié l’histoire de la joueuse d’échecs ougandaise Fiona Mutesa. Mais malgré la présence de Lupita Nyong’o, lauréate d’un Oscar, dans le rôle principal, le drame sirupeux « Queen of Katwa » a été un échec commercial lors de sa sortie en 2016.
Dans la dernière partie de sa carrière, Nair a prospéré en tant que réalisatrice de films commerciaux, tout en restant fidèle à ses convictions et à ses principes. Cela s’est vérifié aussi bien avec les studios hollywoodiens que sur tous les sujets politiques, notamment son attitude envers Israël.
Malgré le succès considérable de ses premiers films en Israël, elle a décliné l’invitation du Festival de Haïfa à y participer en tant qu’invitée d’honneur en 2013 : « Je ne viendrai pas en Israël pour le moment. Je viendrai en Israël quand l’occupation sera terminée. Je viendrai en Israël quand l’État ne privilégiera pas une religion par rapport à une autre. Je viendrai en Israël quand l’apartheid sera terminé », a-t-elle expliqué dans un tweet. À cette époque, Zohran avait déjà 22 ans, et on ignore s’il l’a influencée dans son refus de l’offre des organisateurs du festival israélien, comme ce fut le cas pour la proposition de Warner Bros. concernant la saga à succès Harry Potter. Il est toutefois clair que cette position politique est en accord avec sa vision d’Israël, telle qu’il l’a exprimée par le passé.
La Première Dame de New York
Sans entrer dans une analyse psychanalytique des complexités maternelles, on peut affirmer que la nouvelle épouse de Zohran, Rama Dewaji, jeune Américaine musulmane d’origine syrienne, partage la même position idéologique et anti-israélienne que les Mamdani. Née en 1997 à Houston, au Texas, elle a, comme les parents de son mari, émigré avec eux à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où elle a passé une grande partie de son enfance. Selon elle, cette expérience fut loin d’être heureuse et elle trouva un certain réconfort dans les dessins qu’elle griffonnait dans ses cahiers. Devenue adulte, le talent qu’elle avait cultivé dès l’adolescence l’a conduite à étudier l’art à Doha, au Qatar, puis à l’Université Virginia Commonwealth, aux États-Unis.
Rama s’est finalement installée à New York il y a quatre ans, et son histoire d’amour avec Zoharan a débuté, aboutissant à un mariage civil dans la ville (et plus récemment en Ouganda). La nouvelle Première dame de New York incarne la jeunesse contemporaine de la ville, plus tournée vers la création artistique que vers Wall Street, et qui délaisse les costumes et cravates au profit de tenues à la mode, voire audacieuses, à l’encontre des normes professionnelles ou des préceptes du conservatisme religieux (des photos d’elle dans des tenues particulièrement indécentes ont suscité la polémique sur Internet).
l’instar de Zoharan, elle donne la parole à une nouvelle génération qui aspire à une influence politique. Tandis que son mari s’engage dans l’activisme politique, Rama continue de s’exprimer à travers les illustrations qu’elle partage sur les réseaux sociaux, dont beaucoup affichent un sentiment pro-palestinien et dénoncent Israël depuis le 7 octobre. Nul doute que la mariée a rejoint la bonne famille sur le plan idéologique : femme indépendante qui rejette la tradition et l’héritage familial, elle puise sa force dans l’art pour mener une action politique. Qui sait, peut-être qu’un jour elle sera un personnage d’un film sur la belle-mère.
JForum.Fr & YNET
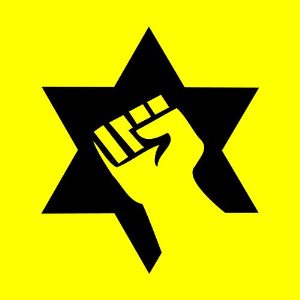
Sa mère n est pas juive…..
Les milieux bourgeois « intello »donc bobos voteront en masse pour ce genre d´individu.Donc pour la France Paris et pour l´Allemagne Berlin,2 villes quasiment vidées des populos pourraient devenir comme New-York,des villes islamo-gauchiste.Mais cela pourrait trés vite se terminer,la bulle va éclater,ne serait-ce qu´économiquement,qui investira dans ce genre de merdier?
Sinon madame Merkel a préféré se rendre en Israel plutôt qu´á l´anniversaire de Merz la « calamité ».Beaucoup de gens reprochent á madame Merkel l´entrée massive de migrants,il est vrai,mais d´un autre côté j´éprouve malgré tout pour elle beaucoup de respect.
Sinon en Allemagne la gauche « Die Linke »sont en pleine baston interne.Une trés grande partie d´entre-eux tournnent ouvertement S.A,inquiétant car ils touchent beaucoup de jeunes.Pour la minorité qui dénoncent la majorité antisémite,certains ont été ouvertement menacé.
Des personnes de la CDU demandent á l´état de tenir á l´oeil les LINKE….
Sinon Jocelyne á trés bientôt comme prévu😊
👉✡️✝️🙏
hier encore ce mamdani a reaffirmè ordonner l arrestation de netanyahou s il mettait le pied a new york!sauf que cet islamiste radical n a pas le pouvoir d une telle action contre un premier ministre d israel se rendant aux nations unies!ni netanyahou ni aucun chef d etat en route vers l onu !situèè a new york!mais il le dit et le proclame devant toute cette racaille negro islamique de new york !!qui chante free palestine comme des robots programmès ne sachant meme pas ce qu est cette palestine ……