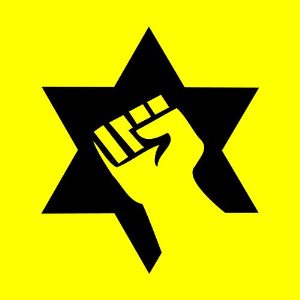Douglas Murray : « En ne croyant plus en lui, l’Occident a ouvert la porte à ses ennemis »
ENTRETIEN. Dans « Les Démocraties et la Mort », l’essayiste ausculte un monde qui glorifie la mort et méprise la vie – et un Occident en train de s’anéantir à force de s’oublier.
Les faits sont bruts, documentés, insoutenables. Le matin du 7 octobre 2023, pendant que certains s’éveillaient à peine, d’autres enregistraient – et diffusaient – en direct la jouissance qu’ils tiraient du massacre. Un monde regardait. Un autre exultait. À New York, Douglas Murray fixait les mots et les images, puis, sans délai, prenait la route d’Israël.
De ce voyage – et de l’abîme qu’il révèle –, le journaliste et intellectuel britannique a tiré un essai aussi furieux que lucide, Les Démocraties et la Mort. Israël, l’islamisme et nous*. Mais, loin du simple cri de colère, l’ouvrage tisse une méditation sur ce que signifie défendre l’Occident quand celui-ci ne sait plus ce qu’il est – ni s’il mérite encore d’être défendu, et encore moins sauvé.
Le Point : De vos débuts néoconservateurs à votre réflexion actuelle sur le déclin civilisationnel, votre pensée a progressivement basculé d’une défense stratégique de l’Occident vers une défense culturelle et symbolique. Le 7 octobre 2023 marque-t-il une nouvelle étape de cette mue intellectuelle ?
Douglas Murray : Oui, je crois. Le 7 Octobre, j’ai ressenti quelque chose de très proche de ce que décrit Evelyn Waugh au sujet d’un personnage de La Capitulation, au moment de la signature du pacte germano-soviétique : « L’ennemi apparaissait enfin au grand jour, immense et odieux, débarrassé de tous ses camouflages. » Moi aussi, quand j’ai vu ce que faisait le Hamas ce matin-là – des milliers de terroristes marchant sur le sud d’Israël en violant, massacrant, kidnappant, le tout diffusé en direct à travers le monde, la mort glorifiée, la barbarie comme pure jouissance –, j’ai éprouvé un sentiment comparable.
Dans votre livre, le rôle de l’image est central, et l’iconographie de l’horreur est abordée non comme une conséquence mais comme un moteur de la violence. Est-ce là, selon vous, la signature de notre époque : un terrorisme esthétique ?
Non, c’est là une manière très française – dans le pire sens du terme – de voir les choses. L’horreur du Hamas ne tient pas à une question d’esthétique ou d’interprétation. Elle tient au mal. Au mal dans sa forme la plus pure, celui d’une secte qui voue un culte littéral à la mort. Notre défi n’est pas seulement de reconnaître et de nommer le mal quand nous le voyons, mais aussi de réfléchir à ce qui en constitue l’exact opposé : le bien. J’ai rencontré, la semaine dernière au Canada, un couple dont le fils se trouvait au festival Supernova le matin du 7 Octobre. Il a protégé un groupe de jeunes cachés dans un abri pour échapper aux terroristes. Il a renvoyé grenade après grenade, jusqu’à être tué à son tour. Mais, comme je l’ai dit à ses parents, leur fils a sans doute accompli l’un des plus grands actes de bien dont un être humain soit capable : donner sa vie pour protéger la vie.
Vous évoquez tout de même des images que les terroristes eux-mêmes diffusent, dans un geste paradoxal d’exhibition. En quoi cette « modernité perverse » – une barbarie 2.0 – rend-elle les démocraties encore plus vulnérables ?
Comme après Charlie Hebdo, le Bataclan, Samuel Paty et tant d’autres attentats, il nous faut décider si nous allons, oui ou non, nous laisser terroriser par les terroristes – ces individus qui exploitent la puissance des technologies contemporaines pour propager leur barbarie prémédiévale. Je comprends que beaucoup aient peur. Mais notre devoir est d’être à la hauteur, non pas en affichant notre peur, mais en affirmant notre courage, notre héroïsme.
Le terrorisme, écrivez-vous, veut susciter la peur, mais aussi la division. Le piège fonctionne-t-il parce que nos sociétés sont devenues incapables de nommer l’ennemi sans se fracturer de l’intérieur ?
La peur, la division… mais aussi la pure conquête par la force. Je me souviens avoir été profondément marqué, il y a des années, par le témoignage de Philippe Lançon, journaliste de Charlie Hebdo, dans Le Lambeau. En particulier par cette scène où, après sa convalescence, il assiste enfin à une soirée et y croise Michel Houellebecq – qu’il n’avait jamais rencontré auparavant. L’écrivain s’approche de lui et lui dit une seule phrase – tirée, d’ailleurs, de l’Évangile selon Matthieu : « Et ce sont les violents qui l’emportent. » Voilà surtout ce que veulent les hommes de violence : s’emparer, par la force, de ce que nous avons. Est-ce que nous serons capables de les repousser et de les expulser ? Telle est la question.
Dans vos livres, vous décrivez un Occident en proie à une « perte de foi en lui-même ». On ne peut qu’être frappé par cette tentation du reniement – par pitié, par fatigue, par mauvaise conscience. Est-ce, selon vous, une faiblesse passagère ou une pente terminale ?
Il n’y a aucun doute là-dessus. Nous avons vécu en Occident une époque que Roger Scruton qualifiait d’« abnégation de soi » – où nous avons fini par valoriser toutes les traditions, sauf la nôtre. Ce n’est pas seulement une perte de foi en Dieu, le Dieu chrétien, mais aussi une perte de foi en nos propres vertus, en nos valeurs en tant que sociétés. Ce qui nous rend perméables à tout mouvement qui viendrait nous fouler aux pieds en disant : « Vous vous pensez abjects et sans valeur ? Nous sommes du même avis. » Est-ce irréversible ? Nous le saurons bien assez tôt.
Vous insistez sur l’amnésie volontaire de l’Occident, sa honte de lui-même. Ce désamour est-il l’autre nom de son agonie ? Rejoignez-vous l’idée qu’on se saborde culturellement en oubliant ce que nos sociétés ont d’unique ?
Beaucoup d’Occidentaux sont persuadés que notre mode de vie est la norme universelle. Nous sommes comme des poissons qui n’ont pas conscience de l’eau de leur bocal. Les épreuves récentes – notamment l’islamisme – ont rappelé à beaucoup le caractère singulier de notre propre tradition. Mais il subsiste une frange de gens décidés à combattre tout ce qui nous est propre, tout en encensant ce qui vient d’ailleurs. J’ai déjà résumé cette idée par cette métaphore : la vanille n’est pas la saveur par défaut de toutes les glaces, c’est un parfum subtil, complexe, une réussite en soi. Or nous avons voulu y mêler toutes les saveurs imaginables, y compris celles qui la gâtent. Je préférerais que nous nous souvenions de ce qui a rendu notre civilisation à la fois complexe et féconde, et que nous nous appuyions sur ces fondations pour la faire grandir plutôt que de la saboter.
Cela ne veut pas dire qu’il faille nous fermer aux autres traditions – c’est même le contraire de ce que je prône. Mais cela suppose que nous regardions notre identité et notre propre héritage avec justesse et lucidité. Et de toute façon, prétendre que tout ce que nous avons bâti jusqu’ici n’était que corruption ou vanité ne rend service à personne – ni au reste du monde ni aux minorités qui vivent parmi nous. Car qui voudrait s’intégrer à ce que nous jugeons nous-mêmes indigne ?
Vous appartenez à cette « droite intellectuelle » qui critique aussi bien l’islamisme que les tentations autoritaires de l’extrême droite. Pensez-vous encore possible de tenir cette ligne ? D’être, comme vous l’avez écrit, conservateur sans être réactionnaire ?
Je crois qu’il est toujours possible de rester fidèle à ses principes. Je n’aime ni l’autoritarisme ni le totalitarisme. Je n’aime pas davantage le relativisme culturel – et encore moins le suprémacisme culturel dirigé contre ma propre culture. Cela signifie que je n’ai aucun scrupule à critiquer les islamistes ou l’extrême gauche. Mais lorsque je vois des gens de droite céder aux mêmes dérives – y compris à l’antisémitisme, dont une frange de la droite américaine se fait désormais l’écho –, je n’ai aucun mal à les dénoncer aussi. Être conservateur, ça ne veut pas dire être réactionnaire : c’est accorder de la valeur à ce qui est bon et durable, vouloir le transmettre, et même s’appuyer sur ce qui a fait ses preuves. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec la réaction. Si l’on veut chercher les véritables réactionnaires de notre temps, ils sont plutôt du côté des extrémistes écologistes, qui semblent vouloir nous ramener à une société agraire sans énergie viable, et des islamistes, qui rêvent de transformer nos sociétés en Arabie du VIIe siècle. Personnellement, aucune de ces deux options ne me séduit.
Au XXᵉ siècle, nous débattions d’idées différentes ; aujourd’hui, nous nous disputons sur des faits différents.
Vous avez été l’un des premiers à dénoncer l’illusion d’un multiculturalisme pacificateur. Depuis L’Étrange Suicide de l’Europe, cette intuition semble se radicaliser : ce que vous décriviez comme une crise d’identité s’est mué en guerre des images et des récits. Diriez-vous que nous vivons désormais dans un espace post-rationnel ?
Je pense que faire venir en Europe des millions de personnes qui ne veulent pas en faire partie – et qui, pour beaucoup, la détestent – relève d’une erreur civilisationnelle et d’une catastrophe générationnelle. De plus en plus de gens en prennent conscience, et c’est sans doute pour cela que le rabbin Jonathan Sacks, notamment, a pu qualifier mon travail de prophétique. La question, désormais, est de savoir s’il n’est pas trop tard pour inverser la tendance par des moyens pacifiques. Nous le verrons bien. Quant au rationalisme, les gens ont toujours eu le sentiment de vivre à une époque irrationnelle. La différence, aujourd’hui, c’est que la technologie, et tout particulièrement les réseaux sociaux, a démultiplié ce phénomène. Nous en sommes arrivés à une situation que je décris souvent ainsi : au XXᵉ siècle, nous débattions d’idées différentes ; aujourd’hui, nous nous disputons sur des faits différents. Cette dérive est le produit des algorithmes et de l’effondrement d’un ensemble cohérent d’institutions reconnues comme fiables, capables de diffuser ne serait-ce qu’une approximation de la vérité. L’imprimerie a eu des effets qu’aucun de ses contemporains n’aurait pu anticiper. Les réseaux sociaux ont, eux aussi, des conséquences que nous commençons à peine à mesurer.
Dans La Grande Déraison, vous attaquiez la fragmentation identitaire. Dans Les Démocraties et la Mort, vous montrez une fragmentation morale : des morts plus « rentables » que d’autres, des indignations plus « stratégiques ». Est-ce cela, le prix du relativisme ?
La Grande Déraison était d’abord un réquisitoire contre l’idée selon laquelle il fallait fragmenter nos sociétés selon le sexe, le genre, la race et ainsi de suite. Je crois avoir remporté ce débat – pas tout seul, évidemment. Tout indique néanmoins que nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre que la fierté et le sens que l’on peut tirer du fait d’être chrétien, ou français par exemple, ne sauraient se remplacer par des cheveux teints en violet et un piercing à la langue. Quant à la hiérarchie implicite des vies humaines, il est évident que ceux qui ont fait du peuple palestinien – surtout de celui de Gaza – leur dernier fétiche compassionnel manquent cruellement de cohérence. Pas un mot sur le génocide des chrétiens dans le nord du Nigeria – que, pour ma part, j’ai couvert. Pas un mot sur le Soudan, sur la guerre au Yémen, sur les Ouïghours en Chine. Et pas un mot, bien sûr, sur les ateliers clandestins où des enfants, payés une misère, fabriquent ces fringues aussi laides qu’éphémères, portées une fois, jetées aussitôt, et devenues, semble-t-il, indispensables à nos sociétés.
Nous assistons aujourd’hui à la montée d’une compassion tyrannique, qui tord les principes au nom de l’émotion. Vous semblez faire un constat similaire : les émotions collectives deviennent des armes de dislocation. Le cœur est-il devenu l’ennemi de la raison ? Notre empathie est-elle devenue suicidaire ?
C’est un lieu commun de rappeler que le cœur et la raison s’opposent souvent lorsqu’ils cessent de dialoguer. Dans L’Étrange Suicide de l’Europe (2017), j’ai décrit notre rapport à la migration de masse comme une tension aristotélicienne entre deux vertus : la compassion et la justice. La compassion pour ceux qui fuient véritablement la détresse, et la justice envers ceux qui vivent déjà ici. Au départ, c’est la compassion qui a prévalu. Mais il apparaît aujourd’hui avec une clarté croissante que nos dirigeants ont fait preuve d’une profonde injustice – pour ne pas dire d’un mépris complet – à l’égard des sentiments de ceux qui ont toujours habité ce continent, et les conséquences s’en font désormais sentir chaque jour.
Vous décrivez un monde où les sociétés ouvertes sont confrontées à des ennemis qui, eux, ne doutent jamais. Mais on peut aussi dire que « la force des mous » réside dans leur plasticité, leur capacité à ne pas céder au réflexe brutal. Comment concilier cette tempérance démocratique avec la nécessité de se défendre ?
Ce n’est pas une question aussi complexe qu’on voudrait le croire. Oui, l’ouverture a sa valeur. Et l’autocritique, chez une société comme chez un individu, est une vertu précieuse. Mais il y a une différence entre l’autocritique et l’autoflagellation – tout comme entre l’autoflagellation et l’autodestruction. J’ai peur que nos sociétés n’aient récemment développé un penchant pour le masochisme le plus radical. Et, hélas, les sadiques ne manquent pas autour de nous, comme nous pouvons le constater au quotidien. Les masochistes ont-ils oublié de leur fournir un safe word ? Quoi qu’il en soit, c’est une lubie que je ne goûte ni n’approuve. Il y a une différence entre un ami et un ennemi, entre un critique qui cherche à vous faire grandir et un autre qui veut simplement vous anéantir.
Face à la brutalité croissante du monde, quelle vertu démocratique vous semble la plus précieuse à préserver ? Et laquelle est, selon vous, en voie d’extinction ?
Citez n’importe quelle vertu que nos ancêtres tenaient pour essentielle, et vous verrez qu’elle est aujourd’hui menacée : la liberté d’expression, la liberté de conscience, le sens de la fierté civique… La liste est interminable. Et tout commence par une ignorance profonde de nos propres traditions. Je n’ai aucune indulgence pour cette amnésie organisée à l’égard de notre passé – ni pour ceux qui prétendent que moi comme le reste des peuples occidentaux n’avons aucune raison d’être fiers de ce que nous sommes.
Vous semblez dire que le discours humaniste est devenu le camouflage de notre impuissance. Est-ce encore possible, selon vous, de faire coexister les idéaux des droits de l’homme avec un réel instinct de survie civilisationnelle ?
Les droits de l’homme sont une construction – certes raffinée, mais une construction tout de même. Comme l’ont montré Larry Siedentop, Tom Holland et bien d’autres penseurs et historiens auprès d’une nouvelle génération, nous n’aurions même pas l’idée de « droits de l’homme » sans l’héritage des principes et des préceptes issus de notre tradition judéo-chrétienne. Benoît XVI l’avait parfaitement compris. Si vous sciez les racines de l’arbre sur lequel vous êtes assis, combien de temps croyez-vous pouvoir rester en équilibre avant de chuter ?
Une contradiction majeure traverse la gauche dite « woke » : elle prétend défendre les minorités sexuelles et de genre, tout en affichant une indulgence – voire une complaisance – envers l’islamisme et certaines formes de conservatisme culturel issues de l’immigration. Comment expliquez-vous cette dissonance idéologique ? Et pensez-vous que votre propre homosexualité vous donne, non pas une sensibilité particulière, mais une lucidité accrue sur ce paradoxe ?
Pas vraiment. Je ne fais pas partie de ces narcissiques convaincus que le monde devrait tourner autour de leur sexualité. Pour moi, la défense des droits des homosexuels relevait d’une simple exigence d’égalité, point final. Mais depuis quelques années, un mouvement « queer » a surgi – souvent peuplé, ironie suprême, d’hétéros mal dans leur peau – persuadé qu’être « queer » n’est qu’une étape avant de faire table rase du reste : « le patriarcat », « le capitalisme », etc. Eh bien, désolé, mais qu’ils aillent se faire foutre ! Ils pourrissent tout ce qu’ils approchent – les idées comme les gens. Si le mouvement LGB ne se débarrasse pas rapidement de ces fanatiques du genre qui prétendent le représenter, ils finiront par tout faire exploser. Qu’on soit clair : je ne parle pas des homosexuels ordinaires, mais de ces « queers révolutionnaires » persuadés qu’ils doivent marcher main dans la main avec les islamistes. Comment comprendre une telle folie ? C’est ce qui les excite, peut-être ? Plus sûrement, il y va d’une bêtise abyssale née de l’ignorance totale – et proprement colonialiste, d’ailleurs – de ce qu’est le monde réel, au-delà de nos petites sociétés.
Vous avez récemment pris la défense de Kevin Spacey, en rappelant qu’il avait été acquitté par la justice américaine comme britannique. Vous l’avez même invité à lire Shakespeare lors d’une conférence en hommage à Roger Scruton, et accompagné en Israël. Qu’avez-vous voulu signifier à travers ce geste : une défense de l’art, de l’amitié ou une protestation contre la lâcheté ambiante ? Pensez-vous que l’Occident a perdu sa capacité à pardonner, ou même simplement à distinguer entre faute morale et réputation détruite ?
C’était pour défendre un ami dont l’innocence avait été établie. Pour défendre aussi un grand artiste que je voulais aider à retrouver son public. Et, sans doute, pour rappeler à quel point nos sociétés sont devenues sauvagement incapables de la moindre indulgence, tout en se repaissant de lynchages numériques nourris d’un moralisme de pacotille.
Vous avez souvent dénoncé les excès du mouvement MeToo et la logique d’épuration morale qui l’accompagne. Pensez-vous qu’il s’agisse d’un épisode passager ou d’une mutation durable de nos sociétés ? Et, plus largement, la cancel culture vous semble-t-elle être un symptôme de décadence, ou une nouvelle forme de puritanisme moral ?
C’est tout cela à la fois. Mais même si la vague n’est pas tout à fait retombée, elle s’essouffle clairement. C’est particulièrement vrai aux États-Unis, où Donald Trump, en martelant qu’être « woke » revient à être un « gros naze », a su capter l’imagination d’un public largement acquis à cette idée. Tous les jeunes que je rencontre en Europe ou en Amérique, lorsqu’ils ont échappé à la secte genriste, se situent bien plus à droite que moi sur la plupart des sujets. C’est logique : on ne peut pas longtemps convaincre une majorité qu’elle est coupable par naissance. Il n’y a rien de mal à être un homme, rien de mal à être hétérosexuel, rien de mal à être blanc. Le principal responsable de ce renversement, c’est cet « antiracisme » devenu, en réalité, une nouvelle forme de racisme. Ses adeptes sont allés trop loin : au lieu de viser l’égalité, ils ont voulu imposer un « mieux ». Résultat classique d’un mouvement qui, à force de vouloir dépasser sa cause, finit par la détruire.
Les terroristes nous lancent un défi : ils prétendent l’emporter parce qu’ils aiment la mort plus que nous, Occidentaux, aimons la vie.
Vous déplorez que l’Ukraine soit devenue un « pays imaginaire » pour une certaine droite américaine, qui recycle sans vergogne les éléments de langage du Kremlin. Comment expliquer que des militants conservateurs, souvent très critiques envers l’idéologie woke, puissent sombrer dans une fascination pour un autocrate comme Vladimir Poutine ?
À droite, certains bas du front que les excès du wokisme révulsent ont cru que Poutine était ce qu’il prétendait être : le défenseur de la chrétienté occidentale. Soit un rôle pour le moins incongru pour cet ancien officier du KGB. Reste que, après l’avoir vu mobiliser des djihadistes tchétchènes contre des soldats chrétiens en Ukraine et avoir constaté les ravages de ses missiles sur les grandes cathédrales d’Odessa et d’ailleurs, c’est une pitoyable « pensée » contre laquelle je ne peux que m’inscrire en faux.
Dans ce contexte de confusion morale et géopolitique, où des postures « antisystème » amènent certains à soutenir des régimes explicitement antilibéraux, comment continuez-vous à penser une défense cohérente de l’Occident ?
Ce n’est pas compliqué. Nous devons simplement apprendre à nous voir tels que nous sommes, en assumant aussi notre passé. Toutes les sociétés ont commis des fautes, toutes ont péché d’une manière ou d’une autre. Je ne plaide pas pour une version enjolivée de l’Histoire mais pour une lecture juste. Or sur cette base, nous, Occidentaux, avons un héritage d’une richesse exceptionnelle à partager – et surtout à prolonger. J’aimerais que nous chérissions notre tradition, notamment politique, artistique et philosophique, au lieu de tomber dans le piège tendu par ceux qui la défigurent et la remplacent par un récit mensonger. D’autant que tout ce qu’ils proposent en échange – qu’ils soient poutinistes, wokes ou islamistes – est infiniment pire.
Dans un chapitre central de Les Démocraties et la Mort, vous appelez à sauver l’Occident de lui-même. Si vous deviez le faire en une phrase, que sauveriez-vous – et pourquoi ?
Les lecteurs le constateront d’eux-mêmes en parcourant le dernier chapitre – résolument optimiste –, où j’expose justement ce qu’il nous faut, à mes yeux, adopter et défendre. Ce n’est pas un registre dans lequel j’écris par calcul, mais parce que, après avoir passé quasiment ces deux dernières années dans des zones de guerre, j’ai vu ce que signifie véritablement se battre pour la vie. Les terroristes du Bataclan, de la Manchester Arena et du 7 Octobre nous lancent un défi : ils prétendent l’emporter parce qu’ils aiment la mort plus que nous, Occidentaux, aimons la vie. Ce que je leur réponds est simple : « Très bien, venez voir de quel bois on se chauffe. »
Source Le Point