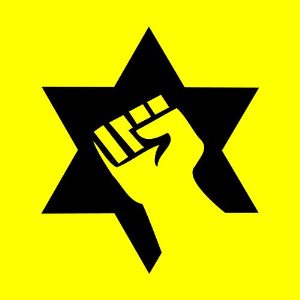Terrorisme islamiste : « La cellule souche est toujours là, et elle est mutante »
INTERVIEW. Le chef de la lutte antiterroriste de la DGSI décrypte, en exclusivité pour « Le Point », une menace « endogène » très forte, portée par des individus de plus en plus jeunes.
Propos recueillis par Sandra Buisson
Six projets d’attentat ont été déjoués cette année sur le sol français et trois attaques y ont été perpétrées. Alors que la menace terroriste qui pèse sur la France reste très élevée, le chef de la lutte antiterroriste de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) détaille les contours du danger terroriste islamiste qui guette l’Hexagone.
Une parole rare, en exclusivité pour Le Point, permettant de cerner une menace qui a changé de visage depuis les attentats du 13 Novembre. Si ceux-ci reflétaient alors la concrétisation de la menace projetée, avec des commandos envoyés de Syrie pour frapper la France, le danger principal vient aujourd’hui de l’intérieur.
La menace dite « endogène » est devenue la plus prégnante, émanant d’individus radicalisés sur notre sol, de plus en plus jeunes, parfois mineurs, fascinés par l’ultraviolence et consommant à outrance de la propagande djihadiste. La plupart de ces individus se réfèrent à l’État islamique mais n’ont pas de lien avec cette organisation terroriste ni avec ses membres. Entretien.
Le Point : Le mois dernier, trois jeunes femmes suspectées de projeter un attentat ont été arrêtées. Dix ans après les attentats du 13 Novembre, qui ont fait 132 morts, comment évaluez-vous la menace qui pèse sur la France ?
Chef de la lutte antiterroriste de la DGSI : La menace est toujours très forte. Nous dénombrons six attentats terroristes islamistes déjoués depuis début 2025, le dernier étant celui que projetaient ces trois jeunes femmes. Il ne faut pas baisser la garde, parce que le terrorisme est un phénomène cyclique. Nous continuons à détecter les signaux faibles et il faut que les citoyens les signalent également. Le terrorisme djihadiste est une maladie mortelle.
Nous avons des traitements qui fonctionnent, mais la cellule souche est toujours là, et elle est mutante. Nos 5 000 agents – environ 50 % plus nombreux qu’en 2014 – s’adaptent à ces mutations. Nous sommes organisés selon un modèle très intégré, qui s’appuie sur le travail quotidien des services territoriaux de la Direction générale de la sécurité intérieure, laquelle est représentée dans de nombreuses villes de métropole et en outre-mer.
Le 13 novembre 2015, des individus ont été envoyés en commando des zones de djihad irako-syriennes pour frapper la France. Est-ce que des attaques similaires sont encore possibles ?
En 2015, les attentats ont matérialisé l’incarnation de la menace projetée. L’État islamique (EI) en Irak et en Syrie avait l’objectif, et les capacités, de porter la menace sur notre territoire. Il a formé des opérationnels et les a projetés à partir de 2014. Il y a d’abord eu des échecs, comme l’affaire Reda Hame et celle du Thalys. Les attentats du 13 Novembre étaient le résultat d’une opération sophistiquée impliquant une pluralité de cibles, d’armes et d’auteurs envoyés depuis la Syrie.
L’État islamique en Syrie et au Khorassan sont en capacité d’activer des individus radicalisés résidant sur le territoire national.
Cette menace projetée est aujourd’hui plutôt contenue. Bien qu’il y ait des filiales de l’EI très vivaces, elles ne nous menacent pas à court terme. J’en veux pour preuve l’absence d’attentat ou de tentative de ce type pendant les Jeux olympiques. Si les organisations terroristes avaient été en capacité de le faire, elles l’auraient fait à ce moment-là.
Contrairement à 2015, l’EI a subi plusieurs défaites en Syrie et s’y trouve affaibli. L’EI au Khorassan (EI-K), en Afghanistan et dans les pays limitrophes est combattu par les talibans et les forces armées pakistanaises. Il fait face à de lourdes pertes et lutte pour reconstituer un territoire refuge.
Quant à l’Afrique de l’Ouest, l’organisation terroriste y fait des ravages. Elle a pour objectif de descendre vers le golfe de Guinée, sur fond d’affrontements avec des groupes rivaux et les armées régulières locales, dans le but de faire tomber des États : le Mali, le Burkina Faso, le Niger… et de descendre plus au sud. Son agenda est très local, pour l’instant.
L’EI en Syrie et l’EI-K sont en capacité d’activer des individus radicalisés résidant sur le territoire national. L’EI-K peut tenter de trouver des relais dans les communautés afghanes ou centre-asiatiques présentes en France. Nous l’avons vu dans le projet d’attentat déjoué en 2022 visant le marché de Noël de Strasbourg et, ces derniers jours, avec l’arrestation d’un Afghan dans un centre de rétention administrative à Lyon, suspecté d’être en contact avec cette organisation.
Quelle est la principale menace que fait peser le terrorisme islamiste sur la France aujourd’hui ?
La menace imminente, principale, c’est la menace endogène, celle qui concerne des individus qui sont sur notre territoire, qui sont de plus en plus jeunes : 70 % des individus interpellés depuis 2023 pour des attentats ou projets d’attentat ont moins de 21 ans. Nous avons de plus en plus de mineurs, parfois des adolescents de 14 ou 15 ans. Ils veulent souvent faire des choses très sophistiquées mais n’en ont pas les moyens et se rabattent sur ce qui est à leur portée, des armes blanches, un véhicule bélier, ce qui rend les passages à l’acte très difficiles à anticiper.
Bien moins nombreux sont les porteurs de cette menace endogène qui sont en lien avec les djihadistes se trouvant sur zone, si l’on compare avec l’année 2015. Nous sommes principalement face à un terrorisme d’inspiration, à une « autonomisation » de la menace. Ces jeunes se radicalisent très vite, embarqués par une propagande très offensive, des formats courts construits pour la jeunesse. Ils n’ont pas de connaissances théologiques poussées, tout au plus un vernis religieux.
1 500 de nos ressortissants sont allés en zone irako-syrienne, c’était le premier contingent européen.
Ils sont le plus souvent isolés, très souvent inconnus du renseignement, parfois même des services de police, s’ils n’ont commis aucun fait de droit commun. Leur appétence pour l’ultraviolence les caractérise. Ils se nourrissent à outrance de visionnages de ces contenus sur les réseaux sociaux. Ils sont parfois en situation de souffrance ou d’isolement scolaire, social ou familial. Ils se cherchent un étendard ; or, depuis les années 2010, c’est l’islam radical qui s’avère le plus mobilisateur.
Dans le cas des mineurs, la difficulté est de différencier ceux qui sont prêts à passer à l’acte de ceux qui sont dans une démarche d’opposition à l’autorité propre à l’adolescence, bravaches, un peu forts en gueule, mais qui n’agiront pas. Par ailleurs, de 15 à 20 % des individus suivis par la DGSI souffrent de troubles psychologiques ou psychiques documentés, rendant leur passage à l’acte très difficile à détecter.
Quel risque représentent les détenus pour terrorisme islamiste et les prisonniers radicalisés dans cette menace endogène ?
Cette population est un axe fort de la DGSI : 1 500 de nos ressortissants sont allés en zone irako-syrienne, c’était le premier contingent européen ; 50 attentats nous ont frappés, faisant 280 morts. La réponse répressive a été forte et explique le nombre important de détenus. Incarcérés, ils sont suivis par le Service national du renseignement pénitentiaire. Il y a actuellement 300 détenus pour terrorisme islamiste et entre 300 et 400 détenus de droit commun radicalisés.
L’Etat islamique est devenu la figure tutélaire du djihadiste, la source d’inspiration du passage à l’acte.
Depuis 2019, nous avons été amenés à suivre près de 600 détenus pour terrorisme islamiste après qu’ils ont recouvré la liberté. Nous évaluons la menace qu’ils représentent et faisons ouvrir des procédures judiciaires pour association de malfaiteurs terroriste dès lors que cela s’impose.
Nous pouvons également avoir recours à d’autres infractions de droit commun ou mettre en œuvre des entraves administratives, ainsi qu’enclencher l’expulsion des individus étrangers. Nous constatons que certains abandonnent la violence, même s’ils maintiennent leur pratique rigoriste de l’islam.
Est-ce qu’Al-Qaïda est encore en position de nous frapper ?
La propagande d’Al-Qaïda cible l’Occident de manière permanente, mais elle a moins d’écho que celle de l’EI. Et, dans les faits, nous voyons très peu d’actes en lien avec Al-Qaïda sur le territoire national. Nous constatons également que les individus de la mouvance endogène se réfèrent la plupart du temps à l’EI, qui est devenu en quelque sorte la figure tutélaire du djihadiste, la source d’inspiration du passage à l’acte. Mais nous remarquons aussi de plus en plus d’individus qui se réclament uniquement d’un islam radical, sans faire allusion à une organisation terroriste.
La chute de Bachar el-Assad, en Syrie, a-t-elle eu un impact sur la menace terroriste ?
Ahmed al-Charaa travaille à donner des gages à la communauté internationale. Mais, dans ses troupes, certains ne sont pas sur cette ligne et peuvent glisser vers d’autres organisations, sans qu’il s’agisse forcément de l’EI. Cette organisation ne veut pas d’un État syrien fort. Ils ont donc la tentation d’attiser les tensions communautaires entre les Alaouites, les Druzes, les chiites, les minorités chrétiennes.
La chute de Bachar el-Assad a contribué à ouvrir les portes de certaines prisons, et des membres de l’EI ont été libérés, dont quelques Français. À la faveur de la déroute des forces loyalistes, l’organisation terroriste a pu récupérer des armes et semble, à très court terme, être en cours de réorganisation pour se reconstituer et remonter en puissance.
Hors des prisons et des camps gardés par les Kurdes, nous dénombrons de 100 à 200 Français libres sur zone, dont quelques dizaines autour d’Omar Diaby. Avec la chute de la dictature, Omar Diaby a de nouveau essayé de faire venir des Français, mais il ne faut pas lui prêter une capacité d’attraction plus forte qu’elle n’est.
La chute de Bachar el-Assad a donné envie à quelques dizaines de Français de rejoindre la Syrie. Quelques-uns seulement ont réussi à rejoindre la zone, les autres ont tous été entravés. C’est sans commune mesure avec le phénomène que nous avons connu à partir de 2012.
Comment évoluent les femmes et les enfants de retour de Syrie ?
Un suivi sécuritaire est en place, certaines femmes sont encore radicalisées mais elles ne sont pas les plus menaçantes, même si on a vu dans le passé quelques actions fomentées par des femmes. La question prégnante est la réadaptation à une vie en France, surtout pour les enfants qui ont vu des horreurs ou y ont participé. Certains peuvent avoir des épisodes de violence qui révèlent un mal-être. C’est très divers et mouvant. Le trauma pourrait ressortir un jour. Nous sommes vigilants.
Les organisations terroristes djihadistes ont toujours visé Israël et la communauté juive, l’attentat de Mohammed Merah en est une matérialisation. C’est une cible très mobilisatrice pour la mouvance endogène. La riposte d’Israël au 7 octobre 2023 a ravivé l’antisémitisme. Cela peut agir comme un catalyseur chez les individus radicalisés, en alimentant l’idée d’un antagonisme entre l’Occident et les pays musulmans. Depuis 2012, nous dénombrons 7 attentats et 11 projets ayant visé la communauté juive en France.
Source Le Point